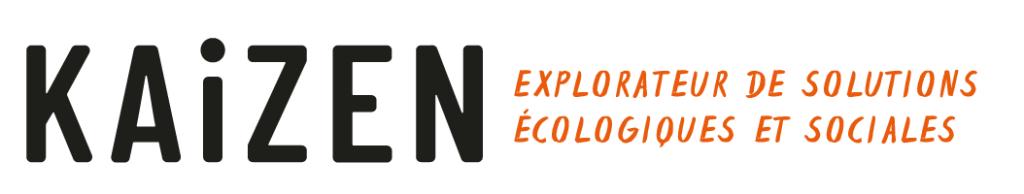Elle est partout, et pourtant elle manque. Dans les nappes, les rivières, les sols, les fontaines. L’eau douce devient, partout sur la planète, une ressource critique, convoitée, surexploitée, parfois détournée. Dans les décennies à venir, les tensions autour de l’eau pourraient devenir aussi structurantes que celles liées à l’énergie ou à l’alimentation. Crise hydrique mondiale, conflits d’usage, fragilité des écosystèmes, régulation citoyenne : enquête sur le premier bien commun globalement menacé.
Une pression sans précédent sur l’eau douce
D’après le dernier rapport mondial de l’ONU sur la mise en valeur des ressources en eau (WWDR 2023), plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable sûre. À l’horizon 2030, la demande mondiale en eau pourrait dépasser de 40 % les ressources renouvelables disponibles si les usages ne changent pas.
Ce stress hydrique n’est pas qu’un problème de pays “du Sud”. Il s’intensifie aussi en Europe. En France, plus de 1000 communes ont été touchées par des restrictions d’eau en 2022 et 2023, et certaines nappes phréatiques atteignent des niveaux historiquement bas, même en hiver.
Des causes multiples, mais interconnectées
Les causes de la crise hydrique sont systémiques :
- Le changement climatique, qui perturbe les régimes de pluie et accentue l’évaporation
- L’agriculture intensive, grande consommatrice d’eau (70 % des prélèvements mondiaux)
- La pollution (nitrates, pesticides, microplastiques) qui rend l’eau impropre à l’usage
- L’urbanisation, qui imperméabilise les sols et réduit la recharge naturelle des nappes
- Et enfin, la privatisation ou la captation des ressources par des acteurs industriels
Une ressource vitale devenue objet de tensions
Quand l’eau se fait rare, les conflits d’usage émergent. Agriculture vs zones humides, industrie vs rivière, loisirs vs potagers, sécurité vs écosystèmes.
En France, la question des « méga-bassines » cristallise ces tensions. Ces immenses réservoirs artificiels, alimentés par pompage dans les nappes, visent à sécuriser l’irrigation de quelques exploitations agricoles, au détriment de l’intérêt général selon les opposants. Plusieurs collectifs citoyens et scientifiques dénoncent une privatisation déguisée d’un bien commun.
Vers une gouvernance locale, sobre et démocratique ?
Face à cette réalité, des alternatives émergent partout dans le monde :
- En Bolivie, à Cochabamba, une insurrection populaire en 2000 a contraint l’État à annuler la privatisation de l’eau.
- À Paris, la régie municipale Eau de Paris a démontré qu’un modèle public, transparent, non lucratif est possible.
- En Espagne, au Maroc, en Inde, des communautés villageoises réactivent des savoirs anciens de collecte et de partage : puits collectifs, irrigation gravitaire, digues de ruissellement.
Et si l’eau devenait un “commun” reconnu juridiquement ?
De plus en plus de juristes et d’associations proposent une requalification de l’eau en “commun”. Ni propriété publique exclusive, ni bien privé, mais ressource partagée devant être co-gérée par les usagers, les collectivités et les écosystèmes eux-mêmes.
C’est ce que prônent des organisations comme la Fondation Danielle Mitterrand ou le mouvement pour les droits de la nature.
Un fleuve, une nappe, un bassin versant : et si nous apprenions à penser en cycle, plutôt qu’en canalisation ?