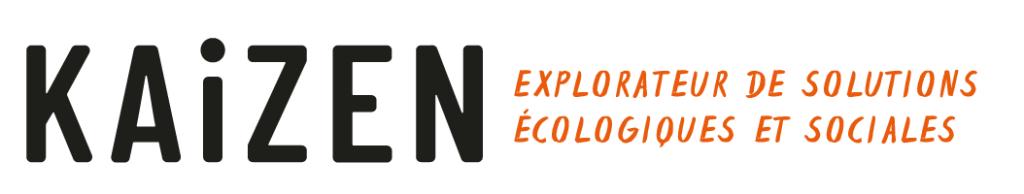Dans les vergers, des fruits à terre
Un matin brumeux de fin septembre, dans un verger du Val de Loire. L’air sent la pomme fraîche et humide, mais le sol raconte une autre histoire. Sous les branches, des dizaines de fruits jonchent l’herbe. Certains sont éclatés, d’autres tachés, la plupart parfaitement comestibles. Paul, producteur depuis trente ans, soupire en ramassant une pomme encore ferme.
« Celle-là, je pourrais la vendre au marché. Mais la coopérative n’en veut pas : trop petite, trop biscornue. Résultat : elles finissent ici, au sol, ou dans la benne. »
Chaque automne, ce scénario se répète. Des tonnes de fruits et légumes quittent les champs pour être… refusés. Le crime n’est pas sanitaire : il est esthétique, économique, systémique.
Les critères de la grande distribution
Dans les entrepôts de Rungis comme dans ceux de Perpignan, les palettes s’entassent. Ici, des courges jugées “trop grosses”. Là, des pommes “hors calibre”. Partout, le même constat : ce qui ne correspond pas aux standards des rayons est relégué.
« J’ai déjà vu un camion entier de potirons partir à la décharge, raconte un saisonnier. Pas parce qu’ils étaient mauvais, mais parce qu’ils ne rentraient pas dans les caisses standard. »
Selon l’Ademe, près de 150 kg de nourriture par personne sont gaspillés chaque année en France. En automne, période d’abondance, la mécanique s’accélère.
Les initiatives citoyennes : glaner pour sauver
Face à ce scandale, des collectifs s’organisent. À Tours, chaque week-end, l’association Les Glaneurs solidaires rassemble habitants et bénévoles. Leur mission : récupérer ce que la distribution laisse de côté.
Sarah, 28 ans, enfile ses bottes dans un champ de courges. Elle rit en soulevant un spécimen difforme :
« Trop moche pour Carrefour, mais parfait pour une soupe ! »
Le soir, plusieurs dizaines de kilos de légumes remplissent les paniers. Une partie est redistribuée gratuitement à des familles, l’autre transformée en repas collectifs.
Le paradoxe social
En France, près d’un foyer sur dix vit l’insécurité alimentaire. Nadia, mère de deux enfants, le vit au quotidien :
« Les banques alimentaires nous aident, mais c’est dur. Quand je vois tous ces fruits jetés alors que mes enfants aimeraient en avoir plus, c’est incompréhensible. »
Entre abondance gaspillée et pénurie vécue, la fracture est criante. Le gaspillage n’est pas seulement une perte écologique : c’est une injustice sociale.

Des alternatives, mais pas assez
Certaines communes innovent. À Grenoble, les marchés de rebus vendent à prix réduit des fruits et légumes imparfaits. À Nantes, des AMAP proposent des paniers “zéro gaspi” avec les excédents des producteurs. Des applications comme Too Good To Go ou Phoenix permettent d’écouler les invendus de commerces et restaurants.
Mais ces solutions restent fragmentées. Elles révèlent surtout que le gaspillage est évitable, si la volonté politique et logistique suit.
L’urgence d’un changement de modèle
Le gaspillage alimentaire est plus qu’une aberration : il est le symbole d’un système qui privilégie les normes commerciales à l’essentiel – nourrir les gens. Derrière chaque fruit jeté, il y a de l’eau, de l’énergie, des heures de travail, des hectares de terre cultivée.
« Quand on laisse pourrir des pommes au sol, on gaspille bien plus que des fruits. On gaspille la planète », résume Paul, le producteur.
Un automne à réinventer
Ce reportage montre une évidence : l’automne pourrait être la saison du partage, de l’abondance solidaire. Il est encore trop souvent celui du gaspillage.
Mais chaque compote préparée avec des pommes tachées, chaque soupe cuisinée avec une courge biscornue, chaque panier sauvé du rebut est un acte de résistance joyeuse. Refuser de jeter, c’est refuser l’absurde.
Et si, cette année, nous faisions de l’automne non pas la saison du gaspillage, mais celle de la créativité et de la justice alimentaire ?