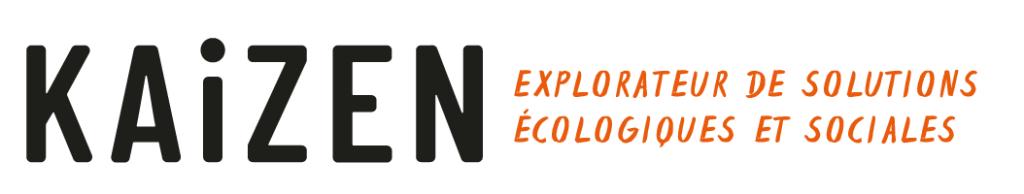Le 8 juillet 2025, le Parlement a définitivement adopté la loi Duplomb, malgré l’opposition de nombreux collectifs citoyens, syndicats agricoles alternatifs, chercheurs et médecins. Présentée comme une réponse aux mobilisations paysannes du début d’année, cette loi se veut pragmatique. Mais en cherchant à “simplifier” certaines règles agricoles, elle ravive de profonds clivages : entre modèles productivistes et démarches agroécologiques, entre urgences économiques et impératifs sanitaires.
Un retour sous conditions… mais à quel prix ?
Le texte autorise à nouveau, sous conditions, l’usage de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit depuis 2020. Concrètement, cela concerne certaines cultures jugées sensibles comme la betterave ou la noisette. Pour les partisans de la mesure, c’est une nécessité pour préserver les rendements face aux ravageurs. Pour d’autres, c’est un signal d’alarme.
De nombreuses études alertent en effet sur les effets des néonicotinoïdes, même dits « modérés », sur la santé des pollinisateurs. Mais l’inquiétude ne s’arrête pas là. Des médecins et chercheurs rappellent que l’exposition à ces substances, même à faibles doses, est suspectée d’être associée à divers troubles : perturbations endocriniennes, effets neurologiques, et dans certains cas, liens probables avec des cancers. La Ligue contre le cancer a pris une position claire contre la loi, estimant qu’elle constitue une atteinte au principe de précaution, notamment pour les enfants et les travailleurs agricoles.
Ces dernières années, de plus en plus de publications scientifiques ont documenté les effets cumulatifs des pesticides sur la santé humaine. Certaines molécules persistent dans l’air, dans l’eau, dans les sols, mais aussi dans les corps. Il ne s’agit pas d’alarmisme : il s’agit d’éthique. Le débat ne porte pas uniquement sur les pratiques agricoles, mais sur le droit fondamental à vivre dans un environnement sain.
Entre fracture agricole et fracture sanitaire
La loi Duplomb ne concerne pas uniquement l’acétamipride. Elle prévoit aussi des simplifications pour les projets de stockage de l’eau, des assouplissements pour la construction de bâtiments d’élevage, et un élargissement du pouvoir des préfets à déroger aux règles environnementales. Autant de points qui, pour ses soutiens, permettront de “redonner de l’air” aux agriculteurs. Mais pour nombre de collectifs, cela revient à fragiliser les garde-fous qui protègent les populations.
Du côté des agriculteurs eux-mêmes, le paysage est loin d’être uniforme. Tandis que la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs saluent un “texte de bon sens”, la Confédération paysanne, des syndicats d’apiculteurs, des associations de malades, mais aussi de nombreux agronomes, dénoncent une régression. Une agriculture qui veut produire plus vite, mais à quel prix pour la santé publique ?
Plusieurs députés d’opposition, issus de divers partis, ont d’ailleurs annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel, arguant que le principe de non-régression environnementale, inscrit dans la Charte de l’environnement, n’a pas été respecté.
Et maintenant ?
Le gouvernement promet un suivi annuel de l’usage des substances réintroduites, et un réexamen global d’ici trois ans. Des comités de surveillance devraient être mis en place, associant experts, représentants de filières et membres de la société civile. Mais pour beaucoup, ces garanties sont insuffisantes, voire illusoires. L’enjeu ne se limite pas à un cadre technique : il engage une responsabilité collective.
Le sentiment qui domine, chez ceux qui alertent depuis des mois, est celui d’une santé publique reléguée au second plan. Non par négligence, mais par choix politique : celui de maintenir un modèle agricole dépendant des intrants chimiques, en dépit des preuves scientifiques qui s’accumulent.
Cultiver autrement, c’est aussi soigner autrement
À l’opposé du modèle que cette loi semble encourager, des milliers d’agriculteurs font aujourd’hui le pari du soin. Soin de la terre, soin des êtres vivants, soin de la santé humaine. Ils travaillent en bio, en agroécologie, en polyculture, souvent à petite échelle. Ils réinventent des pratiques ancestrales ou expérimentent de nouveaux équilibres.
Ils ne sont pas “hors-sol”. Ils produisent, parfois avec moins de subventions, avec plus d’incertitudes, mais aussi avec un engagement profondément humaniste : celui de nourrir sans nuire.
Chaque choix législatif est un message. Celui que véhicule la loi Duplomb interroge : dans une époque où les crises environnementales et sanitaires se croisent, peut-on encore dissocier agriculture et santé ? Peut-on encore faire comme si les pesticides ne nous concernaient que dans les champs, et non dans nos verres d’eau, nos nappes phréatiques, nos corps ?
Ce texte ne signe pas la fin d’un combat, mais il en révèle l’urgence. Une urgence à penser l’agriculture comme un bien commun, au croisement du vivant, de l’alimentation et de la santé.