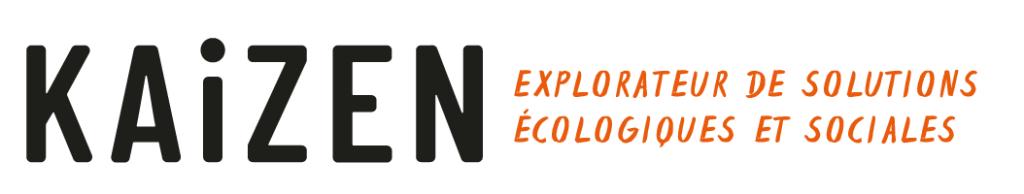“Quand novembre ressemble à avril : vivre dans des saisons sans repères
Un article à la fois poétique et journalistique, ancré dans l’actualité climatique de fin 2025, avec témoignages, analyse écologique et pistes concrètes de résilience.
Le silence d’un hiver absent
Il fait 17°C un matin de novembre dans le Tarn, 19°C à Lyon, 20°C à Marseille.
Sur les marchés, les fraisiers refleurissent, les abeilles volent encore, et les poêles à bois restent froids.
L’hiver, ce temps de retrait et de repos du vivant, ne vient plus.
Ce qui, autrefois, paraissait exceptionnel devient la norme.
La douceur persistante, les pluies irrégulières, l’absence de gel — tout cela bouleverse la cadence intime du monde.
Les arbres s’épuisent à bourgeonner trop tôt, les oiseaux migrent trop tard, les sols ne se régénèrent plus.
“On n’a plus vraiment quatre saisons, on a une longue parenthèse de dérèglement.”
— Marie-Andrée Leclerc, maraîchère en Lot-et-Garonne
Face à ces hivers fantômes, une question s’impose : comment continuer à vivre, à cultiver, à ressentir, dans un temps qui ne respire plus comme avant ?
La désynchronisation du vivant
Quand la nature perd le rythme
Les saisons sont les battements cardiaques du vivant.
Elles régulent la floraison, la migration, la reproduction, la dormance.
Mais depuis une décennie, ce tempo s’emballe ou s’interrompt.
Les naturalistes parlent de désynchronisation écologique : les oiseaux migrateurs trouvent les insectes disparus, les arbres fleurissent avant la venue des pollinisateurs, les sols ne gèlent plus assez pour tuer les parasites.
“Le froid, c’est le grand hygiéniste du vivant”, rappelle Frédéric Hédelin, forestier dans le Jura.
“Sans gel, les ravageurs se multiplient, les arbres n’ont plus de pause, et la forêt vieillit plus vite qu’elle ne se renouvelle.”
La nature, autrefois métronomique, devient imprévisible.
Et avec elle, c’est tout notre rapport sensoriel au temps qui s’effrite.
L’hiver, ce temps du corps et du mental
L’humain aussi perd pied.
Notre sommeil, notre appétit, notre humeur sont profondément liés à la lumière et aux cycles saisonniers.
Quand la saison froide disparaît, notre organisme se dérègle :
on dort moins, on peine à se recentrer, on vit dans un printemps permanent et épuisant.
Les médecins parlent de “fatigue climatique”, un phénomène encore peu étudié mais observé partout en Europe.
Nous avons besoin d’hiver — pas seulement pour la nature, mais pour notre écologie intérieure.
“L’hiver est la respiration du monde. Sans lui, on reste en apnée.”
— Claire Baudin, thérapeute du sommeil
Les conséquences invisibles : agriculture et biodiversité
Des récoltes en avance… et en danger
Pour les agriculteurs, l’hiver doux est une fausse bonne nouvelle.
Les semis lèvent plus vite, mais les plantes s’épuisent avant la floraison.
Les gelées tardives du printemps viennent ensuite brûler les bourgeons précoces.
En 2025, plus de 40 % des vergers français ont connu des pertes liées à ce décalage climatique.
“En février dernier, mes pommiers étaient déjà en fleurs”, raconte Patrick Ménard, arboriculteur en Ardèche.
“Puis le froid est revenu une semaine : tout a noirci. On perd des années de travail à cause d’une saison qui n’existe plus.”
La douceur favorise aussi la prolifération des maladies fongiques et des ravageurs, qui ne connaissent plus de trêve hivernale.
Les agriculteurs s’adaptent, mais à quel prix ?
La biodiversité en perte de repères
Le dérèglement des saisons ne tue pas brutalement : il désaccorde.
Les grenouilles pondent trop tôt, les abeilles sortent quand il n’y a plus de fleurs, les ours sortent de leur tanière avant la fin du repos.
Ce désordre progressif fragilise la résilience de chaque espèce.
En France, la LPO observe un recul de 40 % des oiseaux migrateurs à courte distance depuis 2010.
Non par disparition immédiate, mais par lente asphyxie du calendrier biologique.
“L’hiver, c’était le moment du silence, de la régénération. Maintenant, la nature ne se tait plus — elle s’épuise à force de rester éveillée.”
— Jean-Pierre Giraud, ornithologue bénévole

Réapprendre à vivre sans repères fixes
Adapter nos gestes, pas nos désirs
Face à ce dérèglement, deux tentations guettent : le déni ou la résignation.
Entre les deux, une voie se dessine : l’adaptation consciente.
Dans les jardins, cela signifie observer avant d’agir, semer plus tard, pailler davantage, privilégier les espèces rustiques et locales.
En permaculture, certains cultivent des variétés issues du sud, mais dans un équilibre réfléchi :
ne pas importer, mais accompagner le changement.
“L’avenir, c’est une agriculture qui danse avec le climat au lieu de lui résister.”
— Élodie Gravier, formatrice en agroécologie
Dans les maisons aussi, la résistance s’invente :
moins de chauffage l’hiver, plus d’aération, de régulation naturelle de la température.
Les architectes parlent désormais de bâtiments résilients, capables d’absorber les écarts plutôt que de les combattre.
Réhabiliter le temps long
Le dérèglement climatique a surtout abîmé notre rapport au temps.
L’urgence est devenue permanente.
La maison, la terre, le corps : tout fonctionne en flux tendus.
Retrouver un rythme, même artificiel, devient un acte écologique.
Programmer des temps de repos, ralentir la production, redonner au travail et à la consommation leur saisonnalité.
Faire de l’hiver retrouvé un état d’esprit : celui du retrait, de la sobriété, du silence fertile.
Pistes de régénération
- Planter pour demain : haies, arbres fruitiers, espèces rustiques adaptées aux excès climatiques.
- Observer avant d’agir : noter les décalages de floraison, les dates de gel, les signes du vivant.
- Créer des microclimats : mares, bosquets, brise-vents, refuges à biodiversité.
- Réintroduire le repos : dans les sols, les rythmes de travail, les usages énergétiques.
- Agir collectivement : rejoindre un collectif de plantation, une AMAP, un atelier de résilience locale.
Le temps du monde se dérègle, pas notre capacité à le réparer
L’hiver qui ne vient plus nous prive d’une part de poésie, mais aussi d’une boussole.
Et pourtant, derrière ce dérèglement, se cache une invitation : retrouver le lien avec les cycles du vivant.
Nous ne pourrons pas faire revenir les hivers d’autrefois.
Mais nous pouvons réinventer des hivers intérieurs, des pauses nécessaires dans la frénésie du monde.
Des moments où la lenteur devient soin, où le silence redevient fécond.
“Il n’y a plus de saisons, dit-on. Peut-être.
Mais il y a encore des gestes pour réparer le temps.”